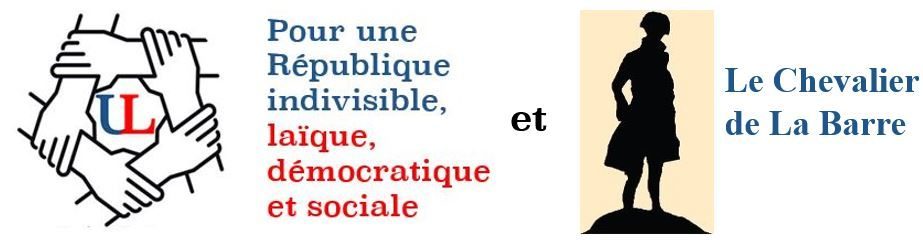Guerre des mots : « Le concept de liberté religieuse défie la laïcité » – Marianne
L’article 1 de la loi de 1905 dispose que : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.» – Albin Bonnard / Hans Lucas
Le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État instaure « la liberté de conscience ». Il y a 120 ans. Aline Girard, secrétaire général d’Unité laïque, une association de défense des principes républicains, et Jean-Pierre Sakoun, son fondateur et président, expliquent dans cette tribune pourquoi parler de « liberté religieuse » plutôt que de « liberté de conscience » instille l’idée que la laïcité oppresse les croyants.
« La République assure la liberté de conscience. » Tels sont les premiers mots de l’article 1er de la loi de séparation des Églises et de l’État qui fonde la laïcité, socle de notre contrat social et dont nous célébrons les 120 ans en 2025.
La liberté de conscience inclut toutes les convictions, philosophiques, religieuses, politiques. Pourtant une ritournelle se fait entendre depuis quelques années, nous berçant continuellement d’étranges expressions telles que « liberté de religion » et même « liberté religieuse ».
Piège
L’expression « liberté de religion » a fait son entrée dans le droit français par le biais de la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 qui, dans son article 9, statue que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Pour nous Français, la liberté de religion, c’est-à-dire la possibilité d’en avoir une ou pas, d’en changer, d’y renoncer, etc. n’est qu’une déclinaison possible de la liberté de conscience. La CEDH et la CJUE ont d’ailleurs consacré cette assimilation française de la liberté de religion à la liberté de conscience dans leurs décisions, qui vont très majoritairement dans ce sens.

Ce que ne prévoyait cependant pas le législateur français en 1974, c’est l’irruption de la religion dans notre société profondément sécularisée sous la pression d’un islam conquérant, puis d’un évangélisme qui ne l’est pas moins, tous deux donnant d’ailleurs des ailes à la vieille religion majoritaire, le catholicisme.
Dans ce contexte il est évident que l’irruption du mot « religion » dans la loi – piège qu’avaient su éviter les rédacteurs de 1905 en ne mentionnant que la liberté de conscience et la liberté d’exercice du culte – ouvre une brèche dans le rempart contre le retour du dogme comme norme sociale. Or, profitant de la dynamique en cours, les tenants de la foi contre la loi ont récemment franchi clandestinement une étape supplémentaire en transformant la « liberté de religion » qui conserve encore une forme de neutralité en « liberté religieuse ». Cette légère modification n’a l’air de rien, mais elle transforme radicalement le point de vue sur l’affirmation de la foi dans la société.
Glissement sémantique, glissement conceptuel
Prenons quelques exemples de cette évolution. Le ministère de l’Intérieur écrit sur son site : « La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse » Puis : « La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public » et enfin : « L’État peut parfois adopter des réglementations spécifiques afin de garantir la liberté religieuse ».
De son côté le Conseil constitutionnel publie dans sa revue Titre VII un article titré « La liberté religieuse et le principe de laïcité ». L’auteur, Mustapha Afroukh, maître de conférences en droit public à l’Université de Montpellier, affirme : « L’idée selon laquelle la laïcité et la liberté religieuse sont les deux faces d’une même médaille, qui est au cœur de la loi de 1905, est aujourd’hui traversée par deux logiques opposées : d’une part, à la faveur de la fondamentalisation de la liberté religieuse, l’obligation de garantir le libre exercice des cultes se trouve renforcée, ce qui permet notamment une adaptation de la laïcité à l’évolution du paysage religieux ; d’autre part, s’est imposée, souvent au nom de laïcité, une nouvelle neutralité applicable aux personnes privées qui limite considérablement la liberté religieuse. »
Enfin, le site Vie publique dépendant du Premier Ministre propose une « fiche » « Qu’est-ce que la liberté religieuse ? » et un « éclairage » « L’État, garant de la liberté religieuse ». Ce glissement lexical – de la liberté de religion à la liberté religieuse – révèle un glissement conceptuel et politique, une mutation profonde, une substitution silencieuse et subtile.
Par l’expression « liberté religieuse », absente donc de notre corpus juridique, certains acteurs entendent désormais nous imposer une logique où la foi personnelle pourrait justifier des aménagements au droit commun, glissant ainsi d’une liberté de l’individu à une revendication des groupes religieux à faire valoir leurs normes et fidélités particulières dans la société, certains allant jusqu’à revendiquer le droit de s’opposer aux lois civiles au nom de la foi (par exemple la charia ou loi islamique devenant opposable aux lois de la République). On passe insensiblement, par les mots, d’une obligation de neutralité (laisser chacun libre de pratiquer dans le cadre commun du droit) à une obligation positive de faciliter les pratiques religieuses, y compris par des aménagements au droit commun.
Cette évolution lexicale et doctrinale, qui amène à considérer que la laïcité existerait avant tout pour protéger les religions et les droits des croyants, est la conséquence d’une triple pression dans un monde où l’on ne parle plus que de respect de l’identité religieuse et de droit à l’expression de la foi.
Une triple offensive
Les trois courants identifiables, convergeant dans leur lutte et leur offensive, sont, d’un côté, le travail d’influenceurs agissant sur de vastes réseaux ; de l’autre, la pression de l’islam politique ; enfin, le combat néo-conservateur de l’alt-right américaine en faveur de la liberté religieuse.
Ce déplacement conceptuel s’est nourri tout d’abord du travail d’intellectuels activistes, dont certaines voix ont été adoubées et soutenues par des personnalités politiques irresponsables et qui pour la plupart se placent systématiquement, mais sans l’énoncer, du point de vue des exigences des religions.
L’islam politique est à la manœuvre depuis plusieurs décennies. L’affaire du voile de Creil a été une étape importante dans sa stratégie d’entrisme communautaire et politique, qui a touché, à différents niveaux, presque toutes les catégories de la population se déclarant musulmane. La jeunesse est particulièrement sensible à l’exigence – pour eux non négociable – de la liberté religieuse, dans laquelle ils ne retiennent que le mot liberté.
Plus récente sur la scène politique, la droite chrétienne néo-conservatrice américaine a fait de la « liberté religieuse » un étendard idéologique. La rhétorique de la persécution des croyants par le secularism est devenue un élément central du discours politique de nombreux élus républicains, Donald Trump en tête, qui affirme sans ciller « Séparation de l’Église et de l’État : est-ce vraiment une bonne chose ? […] Nous remettons la religion au cœur de notre pays ». Les nouveaux croisés doivent « identifier les opportunités de faire avancer la cause de la liberté religieuse dans le monde ».
La laïcité en danger
Progressivement, du fait de leur position d’influence, certains ont réussi à réduire la laïcité à la seule coexistence harmonieuse des religions. En se laissant dorénavant contaminer par l’expression « liberté religieuse », qui vient petit à petit grignoter celle de liberté de religion, elle-même inutile variante rhétorique de la liberté de conscience, les pouvoirs publics français désarment la laïcité française dans son combat pour l’émancipation et contre les intégrismes et risquent d’accentuer la fracture séparatiste au sein de la société.
On doit constater l’influence puissante et prolongée d’organismes tels que l’Observatoire de la Laïcité. Celui-ci, malgré sa disparition en 2021 continue d’orienter les errements de l’administration française en y ayant implanté ses partisans à tous les échelons. Ce pouvoir est renforcé par les positions universitaires conquises depuis les années 1990 par les tenants d’une laïcité amoindrie, volontairement confondue avec la coexistence des religions. Enfin il faut regretter l’aveuglement de services de l’État et des collectivités qui ne cessent de confier la formation de leurs cadres et personnels à des organismes et associations qui promeuvent ouvertement ces dérives plutôt que la conception libératrice de la laïcité.
Article signé Jean-Pierre Sakoun et Aline Girard